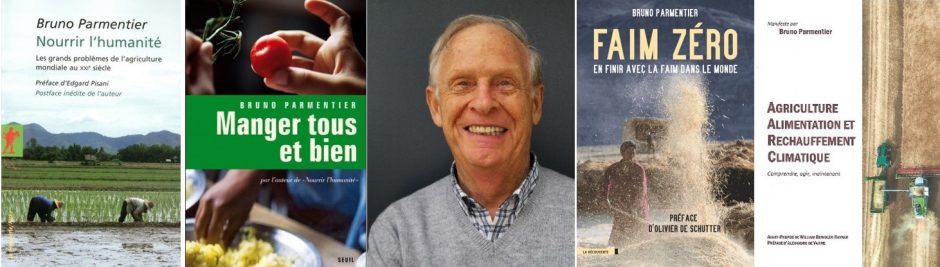Visiblement la crise de l’élevage français, et en particulier breton, n’a absolument pas été résolue depuis l’été 2015. Nous ne pouvons que constater que l’absence de solutions de fond n’a fait que l’aggraver. les éleveurs, désespérés, bloquent les routes. A ce stade de nombreux experts redoutent une hécatombe : 20 à 30 % des éleveurs pourraient carrément déposer leur bilan dans les mois qui viennent, entrainant toutes leurs filières dans une crise économique et sociale historique…
En relisant mes textes de cet été je constate, navré, qu’ils n’ont pas pris une ride… Du coup j’en remonte deux ci-dessous !
Crise de l’élevage, la responsabilité des politiques
Article paru le 24 juillet 2015 sur le site Atlantico
Les éleveurs français sont désespérés et nous le font savoir de façon particulièrement démonstrative. Le gouvernement lâche du lest pour tenter de calmer le jeu. Les positions se caricaturent, raison de plus pour tenter de comprendre les enjeux !
Depuis plusieurs années, un vent libéral souffle sur l’Europe agricole, et les gouvernements successifs, particulièrement celui de Nicolas Sarkozy, ont laissés faire, désespérant de convaincre nos partenaires européens. On démantèle donc toute la Politique agricole commune, disant aux agriculteurs qu’ils doivent dorénavant « répondre aux signaux du marché ». Dernier lâchage : celui du lait avec l’abandon pur et simple des quotas. Seuls les naïfs pouvaient penser que cela allait se passer sans casse !
Dans le lait, par exemple, tous les producteurs européens se sont évidemment mis à garder une ou deux bêtes de plus. Le temps qu’elles grandissent, la production de lait européenne ne peut qu’exploser, et, malgré ce qu’on nous annonce des opportunités d’exporter en Chine, le prix ne peut que s’effondrer et les petits éleveurs ne peuvent que faire faillite.
Aujourd’hui c’est de viande qu’il s’agit, et on fait semblant de découvrir qu’une négociation qui rassemble 130 000 éleveurs dispersés, 130 abattoirs et seulement 4 acheteurs est saine et équitable ! Car il n’y a plus que 4 acheteurs de nourriture qui comptent en France, les 4 groupements d’achats de la Grande distribution qui achètent les ¾ de notre nourriture. Chacun achète donc la production de 30 000 éleveurs français, et peuvent tout aussi bien s’approvisionner en Allemagne, voire au Brésil ! Quel poids les éleveurs peuvent-ils avoir pour se faire entendre, à part celui de bloquer les autoroutes et les accès aux sites touristiques ?
La simple loi du marché, il n’y a qu’à la voir à l’œuvre chez nos voisins européens, ou aux USA : c’est évidemment 10 à 20 000 éleveurs qui vont faire faillite, l’augmentation importante de la taille de nos élevages, moins de développement régional, plus de chômage, plus de malbouffe, le recours à des travailleurs bulgares ou roumains payés au prix de leurs pays dans les abattoirs, des importations sauvages de produits peu contrôlés, etc. Pourquoi fait-on semblant de la découvrir aujourd’hui, et en particulier ceux qui l’ont prôné lorsqu’ils étaient aux affaires ?
La simple loi du marché, c’est la mondialisation dans notre assiette ! Payer toujours moins certes, mais pour avoir une nourriture de plus en plus anonyme et souvent de moins en moins bonne pour la santé.
Faisons un détour historique : toutes les grandes puissances sont toujours intervenues dans la régulation de l’offre de nourriture et la conquête de leur indépendance alimentaire, depuis les empereurs de Chine ou romains, les pharaons égyptiens, jusqu’aux pères de l’Europe agricole après la guerre. En effet le niveau de la production est très fluctuant : sécheresses, inondations, canicules, grêle, maladies, etc. le rendent très incertain. De l’autre côté chacun entend bien manger tous les jours ! Si on ne fait rien, on a des années de surproduction où les prix s’effondrent et les paysans font faillite, suivies d’années de pénuries où les prix montent rapidement et où on a faim en ville. Ce système est maintenant mondialisé, et nos politiques espèrent que les échanges internationaux puissent le réguler. C’est de la folie ! Qui va croire qu’avec les tensions internationales que nous connaissons, le lait de Nouvelle Zélande pourra couler régulièrement dans le bol de nos enfants, ou la viande brésilienne remplir nos assiettes (ou même le soja argentin la mangeoire de nos animaux) ? Quand on le peut, on se doit de manger de la nourriture produite à moins de 500 km de chez soi. Mais si on veut encore des agriculteurs et des éleveurs près de nos grandes villes, il faut les… élever ! C’est-à-dire au moins leur assurer un revenu minimum en cas de crise pour leur éviter d’abattre leurs troupeaux et l’aller pointer à Pôle emploi. C’est ce que le gouvernement tente de faire actuellement en débloquant en urgence des fonds pour faire des allègements ou des reports de dettes. Mais pourquoi ne pas faire cela de façon structurelle, organisée, et attendre que la crise soit aussi profonde ?
En matière agricole et alimentaire, le non interventionnisme se paie très cher. D’accord la loi sauvage du marché mondialisé a fait des merveilles, par exemple pour les chaussettes : on a fait un appel d’offre mondial, ce sont quelques villes chinoises qui l’ont gagné, la Chine produit dorénavant les ¾ des chaussettes mondiales et plus aucune grand’mère ne reprise aucune chaussette ! Mais s’il y a un jour un grain de sable dans la machine, et qu’on manque de chaussettes en France pendant 3 mois, ce n’est pas grave, on en a tous 10 paires d’avance dans nos tiroirs. Vouloir appliquer cela à la nourriture, c’est comme jouer au loto, voire à la roulette russe : imaginons qu’un jour on découvre sur la porte de notre boulangerie la pancarte « aujourd’hui, pas de farine, pas de pain » !
Accompagner la nécessaire mutation de l’élevage français
Nous avons chacun une responsabilité dans cette crise ! Pourquoi n’achetons-nous pas français, chez nous, et surtout pour commencer dans nos cantines scolaires, d’entreprises ou de collectivités ? La viande, comme le reste, mais à commencer par la viande évidemment. L’idée de promouvoir réellement un label « viande française » sans tricheries est excellente ! D’autant que nous sommes un des pays les plus efficaces au monde en matière de contrôles sanitaires.
Mais souvenons-nous aussi que l’agriculture française est encore largement exportatrice ; se réfugier dans un protectionnisme strict n’aidera pas tous les agriculteurs et ne pourra que nuire à notre agriculture in fine…
Mangeons donc, chaque fois que possible, local, équitable, et…de qualité ! Cela nous coutera plus cher, et alors ? Dans les années 60 on consacrait plus du quart de nos revenus à la nourriture, aujourd’hui 13 % en moyenne. Voulons-nous faire comme les allemands qui en sont à 10 % ? Hier on consacrait deux fois plus de revenus à nous nourrir qu’à nous loger, aujourd’hui deux fois moins ; on va bientôt dépenser plus pour nos loisirs que pour manger ! Pourquoi avons-nous admis que c’est sur les économies de nourriture que nous devons payer notre téléphone portable ? Sans compter que la « malbouffe » génère de plus en plus de dépenses médicales ; il serait plus simple de bien manger et d’être moins malade non ?
Et en plus, pour la viande et le lait c’est encore plus compliqué, car on en mange deux fois plus que dans les années 60, plus de 80 et 90 kilos chaque année, et c’est dorénavant beaucoup trop pour notre santé, car cela provoque diabètes, obésité, athérosclérose, cancers, etc., et aussi pour les équilibres écologiques de la planète. Nous commençons à nous en apercevoir et la consommation de ces produits n’augmente plus. Et ce n’est pas en finançant sur les deniers publics des campagnes de promotion de la viande qu’on résoudra le problème de fond.
Nous devrons accompagner une énorme mutation de notre élevage, comme nous avons fini par le faire dans les années 60 et 70 pour le vin, alors que notre consommation commençait à baisser de 140 litres à 42 litres par an et que les viticulteurs étalaient eux-aussi violemment leur désespoir : un changement radical de la quantité vers la qualité pour, in fine, consommer moins, mais « que du bon, que du cher ».
A terme, on ne produira en France que les animaux qu’on pourra nourrir avec les végétaux français (plus d’importations de soja et de maïs sud-américains !), et que de la qualité, toutes les qualités qu’on pourra imaginer, vendue nettement plus chère. Observons que, lors de la précédente crise du lait, tout allait bien en Franche-Comté chez les producteurs de Comté et dans les Alpes chez ceux de Reblochon, et que, quand les bonnets rouges bretons protestaient contre la fermeture d’abattoirs de poulets, tout allait bien chez les producteurs de poulet de Loué, de Bresse et des Landes.
Ce nécessaire changement sera difficile, long et douloureux, et, pour le faire, nos éleveurs surendettés ont vraiment besoin de notre aide. D’autant plus que nous avons légitimement de plus en plus d’exigences environnementales, ce qui les oblige à investir, et que les ressources non renouvelables deviennent de plus en plus rares et chères : engrais, énergie, pesticides. Mais on peut gagner ce combat, si on veut le mener collectivement : songeons qu’aujourd’hui il y a toujours des viticulteurs entre Narbonne et Carcassonne, et qu’on n’y produit plus que du bon vin !
——————————————
Réponses aux questions des internautes du Figaro.fr :
Article paru (en forme résumée) sur le site Le Figaro.fr le 20 août 2015
1./ Pourquoi les éleveurs et agriculteurs ne s’organisent-ils pas pour distribuer eux-mêmes leurs produits sans passer par les industriels ? Serait-ce la solution miracle ?
Bruno Parmentier : Les circuits courts se développent actuellement en France, sous différentes formes ; soit directement aux producteurs : à la ferme (en produits bruts ou cuisinés via les tables d’hôte), en bordure de route, sur les marchés, en paniers collectifs, par Internet, par tournées, etc., soit en direct vers des restaurants ou des artisans. Ils demandent beaucoup plus de travail de la part des agriculteurs qui doivent du coup exercer plusieurs métiers : producteurs, transformateurs et vendeurs. Cette activité touche actuellement près de la moitié des producteurs de miel et de légumes, un quart de ceux de vin et de fruits, et seulement 1/10 des éleveurs (car pour eux c’est beaucoup plus compliqué puisqu’il faut quand même passer par un abattoir puis bien gérer la chaîne du froid et les normes sanitaires). Au total, on estime à 6 à 7 % le poids de ce type de commercialisation en circuits courts dans les achats alimentaires en France. Il y a évidemment des marges de progression possible, mais ce serait une erreur de laisser penser que cette forme de commerce puisse devenir majoritaire. Songeons en comparaison que le bio, qui a fait une énorme progression dans les 10 dernières années, n’est passé que de 2 à 3 % de notre nourriture ! Notre mode de vie urbain nous conduit majoritairement à économiser du temps pour faire les courses et la cuisine ; la grande surface a encore un long avenir devant elle !
D’une manière générale, les éleveurs de porcs qui ont choisi de faire en plus les métiers de boucher, charcutier, stockeur, transporteur, homme de marketing, distributeur et vendeur gagnent mieux leur vie que les autres, mais ce serait bien irréaliste de proposer cette solution à l’ensemble de la filière !
Le créneau le plus prometteur devrait être celui de la restauration collective. Il est quand même extrêmement choquant d’apprendre que dans nos cantines d’écoles, d’entreprises, d’hôpitaux etc., 70 % de la viande vient de l’étranger, avec le prétexte fallacieux de gagner quelques centimes sur le prix du repas. Une mobilisation citoyenne pour re-nationaliser nos achats et sauver collectivement nos emplois serait tout à fait souhaitable en la matière.
2./ Le gouvernement doit-il intervenir dans le marché du porc ? A quel niveau ?
Bruno Parmentier : Historiquement, toutes les grandes puissances se sont toujours préoccupées de réguler l’approvisionnement alimentaire de leur pays, à commencer par leur capitale. Les empereurs de Chine et de Rome, ou les pharaons égyptiens ont montré la voie. Après la deuxième guerre mondiale, les peuples ont exigé de ne plus jamais risquer de devoir utiliser des cartes de rationnement, ce qui a été à la base de la création de la politique agricole commune en Europe, et les États-Unis ont fait de même. Mais traditionnellement, les interventions se sont concentrées sur ce qui semblait à l’époque le plus important, en particulier les céréales, l’huile, le lait, le bœuf et le sucre. Il n’y a pratiquement jamais eu d’intervention directe dans le marché du porc ou du poulet, ni dans celui du vin. Mais on parle là de volonté politique, et rien n’empêche de se donner d’autres priorités. Par exemple, on peut constater qu’on continue à subventionner tout ce qui fait grossir, alors que nous avons maintenant un énorme problème d’obésité. Au final, à la récré dans nos écoles la barre chocolatée est finalement moins chère que la pomme bio !
Rien n’empêche en soi la définition d’une politique de soutien à la transformation de notre industrie du porc et du poulet vers une production de qualité, à la fois pour des objectifs de santé publique, de développement régional et de sauvegarde de l’emploi.
3./ Monter en gamme serait-il une solution à la compétitivité ? Comment le faire ?
Bruno Parmentier : Oui, bien sûr ! Il y a maintenant belle lurette que la plupart des élevages de porcs et de poulet ne sont plus des activités agricoles mais industrielles, hors sol. En fait, il s’agit de transformer le plus efficacement possible du maïs et du soja en tranches de jambon ou en blancs de poulet.
L’année dernière, il y a eu une forte crise dans le poulet en Bretagne. Mais pas dans tout le poulet français. Celui qui s’est trouvé menacé, c’est le poulet « industriel » élevé en batterie à base de maïs et de soja d’Amérique latine pour être vendu congelé au Moyen-Orient. L’Europe a décidé de cesser de subventionner cette activité, et, logiquement, dans le même temps, les Brésiliens se sont dit qu’il était assez logique que ce soient eux-mêmes qui transforment leur matière première, avec des coûts salariaux nettement moins importants, pour fournir le Moyen-Orient ! Ce sont d’ailleurs pour une bonne part des industriels français qui ont été investir dans ce secteur au Brésil ! Mais dans le même temps, à Loué, on n’a cessé de se louer des bons poulets fermier, dans les Landes, on a gardé des mines gourmandes, et en Bresse, les fermières n’étaient pas demanderesses ! Car dorénavant les consommateurs ont bien compris qu’il y a poulet et poulet. Mais pourquoi donc les acheteurs de nos cantines et agro-industries continuent-ils d’acheter du poulet brésilien au fait ? De même pendant la grande crise du lait, dans le comté, on n’était pas du tout remonté !
C’est un peu le même défi qui guette l’ensemble de la filière viande. Dans une époque de mondialisation et de concurrence effrénée, la France ne part jamais gagnante pour faire du produit industriel bas de gamme. D’autres savent faire ça mieux que nous, en profitant de salaires et charges moins élevées (soit directement, dans les pays émergents, soit indirectement comme lorsque les éleveurs allemands utilisent massivement des travailleurs détachés bulgares et roumains sans payer de charges sociales). Et de plus, dans d’autres pays, l’acceptabilité sociale de l’élevage industriel est nettement plus importante. On peut observer qu’à la réunification de l’Allemagne, on y a gardé les grandes exploitations issues des kolkhozes et sovkhozes inefficaces en les transformant en entreprises capitalistes efficaces. Là-bas, une ferme de 1500 vaches laitières ou une porcherie de 1 000 truies ne choquent personne. Au final, le jambon de base allemand est moins cher que le jambon français. À terme, la France ne s’en sortira qu’avec du jambon haut de gamme mieux payé.
Et d’une manière générale, la consommation de viande commence à diminuer dans notre pays ; nous en mangeons beaucoup trop pour être en bonne santé. L’élevage français doit faire la même mutation que la viticulture française dans les années 50 et 60, lorsqu’on a commencé à diminuer drastiquement notre consommation de vin (elle est passée de 140 litres à 40 par an et par personne). Or nous avons toujours une viticulture et des viticulteurs, mais maintenant, en matière de vin, en France il n’y a plus « que du bon, que du cher » !
4./ Rencontre-t-on un problème de surproduction ? Quel effet sur les prix ?
Bruno Parmentier : Oui, il faut le dire, à la base de cette crise il y a une forte surproduction de viande de porc en Europe, à la fois parce que les Européens ont cessé d’augmenter leur consommation de viande, et par ce que les Russes refusent maintenant de nous en acheter. C’est bien évidemment la cause principale de la baisse très importante du prix d’achat du kilo de porc aux producteurs. Lorsque ce prix était supérieur aux coûts de production des français, tout le monde pouvait en vivre, même si les producteurs allemands et espagnols gagnaient plus d’argent que les français. Maintenant, le prix est en dessous de nos coûts de production, les Allemands et les Espagnols ne gagnent plus d’argent mais les Français, eux, en perdent !
Cette situation va perdurer si personne ne fait rien. Il est bien possible que les achats russes ne reprennent jamais, compte tenu de la situation géopolitique en Europe (et que ce ne seront pas nos nouveaux amis arabes ou iraniens qui nous en achèteront !). Et d’ailleurs, en prenant du recul, c’est plutôt une bonne chose pour l’humanité que le gouvernement russe réalise à quel point il était anormal que le plus grand pays du monde, qui ne compte que 130 millions d’habitants, ne soit même pas capable de produire ses cochons et ses pommes. Si cette tension internationale provoque un électrochoc pour qu’enfin les Russes commencent à se mettre à faire de l’agriculture efficace, c’est une vraie note d’espoir pour l’avenir de l’humanité, car on aura absolument besoin de bien cultiver les immenses territoires de Russie pour se nourrir à 9,5 milliards de terriens.
Mais au fait, pourquoi ne pourrait-on pas en Europe réguler les quantités de porc produites comme on l’a fait pendant plusieurs dizaines d’années pour le lait avec un système de quotas : bon an mal an, on n’a plus eu d’excédent de lait pendant toute cette période, et les producteurs laitiers ont pu survivre dans tous les pays et toutes les régions de l’Europe. Et bien entendu, ça ne coûtait pas cher à la société, en tous les cas beaucoup moins de subventionner systématiquement une production, même si ça empêchait un effondrement des prix qui, à très court terme, aurait pu sembler favorable aux consommateurs. Mais seulement à très court terme, car ce consommateur, c’est aussi un salarié qui souffre de l’extension du chômage provoqué par les faillites en chaîne et un contribuable étouffé par les impôts et charges.
5./ La taille des exploitations françaises est souvent pointée du doigt. Faut-il passer à l’échelle supérieure ?
Bruno Parmentier : Si on veut faire du jambon de base et de la côte de porc premier prix, qui serve de produit d’appel dans tous les supermarchés, le tout sans trop grosse atteinte à l’environnement, oui il faut probablement réinvestir dans des élevages de taille plus importante, avec en plus systématiquement des usines de méthanisation du lisier. Mais, connaissant la très grande sensibilité des Français à cette question, comment obtenir un permis de construire pour de telles installations industrielles sans provoquer de broncas régionales ?
Et cela n’empêchera pas l’impérieuse nécessité de construire une Europe sociale, dans laquelle les coûts salariaux tendent à converger, et on interdise de faire travailler des travailleurs détachés sans payer de charges sociales.
6./ Sommes-nous, les Français, contraints par les traités européens ? Si oui, à quel point et par lesquels en particulier ? Sommes-nous plus contraints que d’autres pays ?
Bruno Parmentier : La France reste un grand pays exportateur de produits agricoles et alimentaires. Un abandon pur et simple de la politique agricole commune et de l’ouverture des marchés serait dramatique pour notre pays. Mais cette politique agricole commune se décide maintenant à 28 pays, dont une petite minorité s’intéresse réellement à l’alimentation, essentiellement les pays latins, Grèce, Italie, Espagne, Portugal et France. Pour beaucoup de pays du Nord et de l’Est de l’Europe, les deux qualités principales que l’on recherche dans le jambon sont qu’il soit le moins cher possible, et surtout qu’il soit carré, de la même taille que le pain de mie, pour pouvoir faire facilement des sandwiches insipides.
Nous sommes donc extrêmement contraints avec nos désirs de qualité alimentaire qui ne sont plus majoritaires en Europe. Et bien entendu, si par exemple on voulait appliquer un prix garanti, en laissant filer le prix d’achat du kilo de porc à 1,20 €, et en restituant aux agriculteurs les 20 ou 30 centimes qui leur manqueraient alors pour arriver à couvrir leurs coûts de production, les Allemands et les Espagnols crieraient à la distorsion de concurrence…
Mais, si on écoute les agriculteurs français, il y a encore plus fort : les normes environnementales ou de bien-être animal sont fixés au niveau européen, mais sont appliqués dans chaque pays. Et il semblerait que notre administration soit plus tatillonne que celle des autres pays, voire en profite pour en rajouter en durcissant les règles… Là, on ne parle plus de règles européennes mais d’état d’esprit de notre administration, et de poids du mouvement écologiste dans la société… Il est vrai qu’en Bretagne, boire l’eau du robinet est devenu très hasardeux et, pour se baigner, on a souvent des plages pleines d’algues !
7./ Quelles initiatives ont déjà été tentées dans la filière par les précédents gouvernements depuis les années 60 ? Avec quel succès ?
Bruno Parmentier : A vrai dire, dans le porc, pas grand-chose, car il n’a jamais été subventionné par la politique agricole commune. C’est aussi un secteur, tout comme le vin, peuplé de producteurs relativement individualistes qui n’aiment pas beaucoup les fonctionnaires et les contrôles, mal nécessaire dès que la société intervient financièrement dans une activité.
On peut cependant estimer que les énormes et constantes mesures de soutien au développement des céréales ont historiquement bien profité à ce secteur, qui a pu s’approvisionner durablement avec une matière première de bonne qualité et relativement peu onéreuse. Cette époque est terminée : le prix mondial des céréales est maintenant structurellement élevé, car la demande est littéralement boostée par la demande fortement croissante de viande, d’œufs et de lait des immenses classes moyennes des pays émergents. Donc, sauf catastrophe ponctuelle (sécheresse, inondation, chute provisoire des cours mondiaux), on n’aura plus vraiment besoin de subventionner le secteur céréalier. Mais à l’inverse c’est le secteur de l’élevage est en crise, car il ne peut pas actuellement répercuter la hausse du coût de ses matières premières dans ses prix de vente… Autre temps, autres problèmes, autres politiques à inventer donc. Les gouvernements précédents ont d’ailleurs tenté de transférer une partie du budget de soutien aux céréales pour le secteur de l’élevage, ce qui, logiquement, a provoqué nombre de manifestations de tracteurs de céréaliers tentant de bloquer Paris pour conserver leurs avantages acquis !