J’ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre, en librairie depuis le 4 septembre 2014
FAIM ZERO, en finir avec la faim dans le monde
Présentation plus complète ici même sur la page « FAIM ZERO, le livre »
En avant-première, quelques « bonnes pages » ci-dessous chaque jour de cette semaine.
Dernières « bonnes feuilles », pour le vendredi 12 septembre, des considérations sur les catastrophes naturelles… en n’oubliant pas l’actualité du moment, et le fait que le virus EBOLA va très probablement provoquer plus de morts de faim provoquée par la désorganisation des systèmes alimentaires (récolte, commercialisation, génération de revenus) dans des pays déjà très fragiles, que de morts directs de la maladie… (page 215 du livre)
Contenu de l'article
Comment aider les victimes des catastrophes naturelles ?
L’impact d’une catastrophe naturelle – tremblement de terre, ouragan, éruption volcanique, inondation, invasion de criquets… – varie du tout au tout selon qu’elle survient dans un pays développé et doté d’un État fort, où la solidarité nationale peut jouer très vite, ou dans un pays pauvre et mal administré, exposé à s’enfoncer rapidement dans la maladie et la famine. Les États et les ONG se sont donc organisés pour pouvoir intervenir en urgence. Car chaque jour compte alors pour sauver les blessés coincés sous les décombres, secourir ceux qui ont tout perdu, leur fournir de l’eau potable et un abri, les nourrir, ne pas laisser les épidémies s’installer. Depuis les années 1980, la plupart des grandes ONG (comme les françaises Action contre la faim, Médecins sans frontières ou Solidarités International, ou les anglo-saxonnes Care, Oxfam ou Save the Children) ont constitué dans ce but des stocks d’urgence « prépositionnés » (par exemple à Dubaï, au Kénya ou à Panama) et ont conclu des accords préalables avec des compagnies aériennes pour leur acheminement. De nouveaux métiers de logisticiens d’urgence sont apparus.
Un nombre croissant de catastrophes naturelles majeures
Les séismes, éventuellement accompagnés de tsunamis (vagues géantes) continuent à beaucoup tuer, même à l’époque récente : 227 000 morts par tsunami en Indonésie, Thaïlande et Sri Lanka en 2004, 80 000 au Pakistan (Muzaffarabad) en 2005, 87 000 morts en Chine (Sichuan) en 2008, 230 000 morts en Haïti en 2010, 20 000 au Japon en 2011. Quant aux ouragans, on a beaucoup parlé de Katrina en 2005 qui n’a fait « que » 1 800 morts aux États-Unis. Depuis, Ewiniar a tué 55 000 personnes en Corée du Nord en 2006 et Nargis 138 000 en Birmanie en 2008. Le nombre de personnes éprouvées par les catastrophes est très largement supérieur à celui des décès. Ainsi, les inondations du Pakistan en 2010, qui ont fait au moins 1 760 morts, ont aussi privé 10 millions de personnes de leur logement et affecté 21 millions d’habitants au total.
En moyenne sur la décennie 2003-2012, on a décompté chaque année près de quatre cents catastrophes majeures. Elles ont touché en tout 116 millions de personnes par inondations, 72 millions par sécheresses, 40 par ouragans, 8 par tremblements de terre et 9 par températures extrêmes[1]. Ce sont la plupart du temps les plus pauvres qui sont les plus éprouvés. On observe que les « sinistrés moyens » ne perçoivent en moyenne que 975 dollars de revenus annuels ; un tiers d’entre eux ne disposent pas d’accès permanent à l’eau potable et 45 % n’ont pas terminé leurs études primaires.
Mais c’est lorsque les Occidentaux sont impliqués qu’il apparaît que cela coûte cher, car alors les assurances se mettent en branle (on se rappelle de la focalisation des médias sur les touristes occidentaux lors du tsunami de Thaïlande…). Et plus on est riche, plus elles payent… L’évaluation économique des pertes était de 157 milliards de dollars en 2012. Au-delà des variations annuelles, la tendance est malheureusement à l’augmentation constante, à la fois du nombre de personnes concernées et du coût des catastrophes, reflet du monde d’aujourd’hui : celui du réchauffement de la planète, de l’augmentation de la population… et du niveau de vie des victimes.
Dans de tels cas, il faut parer au plus pressé. Tout d’abord lutter le plus efficacement possible contre la propagation des maladies liées à la pollution de l’eau, particulièrement dans les pays tropicaux où la chaleur humide constitue un véritable foyer d’infection ; donc amener de l’eau potable, ou des systèmes de purification de l’eau, construire des latrines éloignées des réservoirs potables, ramasser et enterrer ou brûler les cadavres, tant des hommes que des animaux… Car sinon ce n’est pas de faim que mourront les victimes, mais de choléra ou de dysenterie.
Ces programmes concernant l’eau, l’assainissement et l’hygiène (les professionnels emploient souvent l’acronyme anglais évocateur WASH, pour Water Sanitation and Hygiene Promotion) ont une telle importance que l’Unicef et la plupart des ONG, telles Médecins sans frontières et Action contre la faim, se sont dotées de réelles compétences en la matière. Lors des collectes d’urgence, l’argent des donateurs sert très souvent dans un premier temps à financer des rotations de camions citernes, des livraisons de kits d’assainissement ou la construction de latrines, ainsi que des formations aux bonnes pratiques d’hygiène et à la gestion de l’eau. Sans oublier les bâches ou les tentes pour se protéger un minimum de la pluie, et les couvertures là où il fait froid.
La deuxième priorité concerne les enfants en bas âge, qui ont peu de réserves (surtout lorsqu’ils ont été préalablement malnutris) et qui sont en grand danger de mort au bout de quelques jours sans manger ; on achemine et on distribue donc le plus rapidement possible des rations alimentaires adaptées à leur situation, car chaque jour passé diminue les chances de survie.
Et enfin, seulement dans un troisième temps, il convient de se substituer provisoirement aux systèmes de distribution locaux de nourriture de base, en particulier dans les camps de réfugiés où le commerce alimentaire ne s’est pas encore organisé. Donc apporter des céréales et légumineuses, un peu d’huile, ainsi que des marmites et du combustible pour les cuisiner. Le degré de priorité de ces opérations dépend de l’état alimentaire et de santé préalable des populations ; car le « risque vital » d’un jeûne forcé de quelques jours n’est pas du tout le même selon qu’on a été bien, mal ou très mal nourri dans les mois précédant la catastrophe…
La tentation d’installer dans la durée cette tâche de distribution directe de nourriture est alors forte, mais c’est en général une grave erreur : rien n’est en fait plus urgent que de favoriser la reconstitution des réseaux commerciaux alimentaires locaux. Dès que l’on peut à nouveau circuler sur les routes, c’est l’épicier local qui doit fournir de quoi se nourrir et non pas le militant d’une ONG ou le fonctionnaire d’une institution étatique ; il le fera mieux et saura s’y prendre pour aider à ressouder les liens culturels et sociaux brisés. De la situation initiale où l’on a amené directement et rapidement de la nourriture, on passe à une autre, infiniment préférable, qui consiste à donner les moyens d’en acheter via les commerçants locaux – provisoirement toujours, mais pour des délais nettement plus longs, qui se comptent en mois ou en années et non plus en jours ou en semaines.
Ce type d’action nécessite une petite « révolution culturelle » au sein des ONG. Leurs militants se sont souvent construits en luttant contre les multinationales, qu’ils jugent en bonne partie responsables de nombre de maux sur terre. Ils opposent constamment la société civile et le monde du business, la gratuité avec la recherche de rentabilité des entreprises, etc. Il leur est donc très difficile de passer des accords avec ceux qu’ils considèrent comme des rapaces. Alors que ces entreprises peuvent aussi faire preuve sur le terrain d’une grande efficacité. Lorsque la Grameen Bank du prix Nobel de la paix (2006) Muhammad Yunus passe un accord avec la société Danone pour produire des yaourts bon marché au Bangladesh, elle fait grincer des dents, mais les avancées sur place sont bien concrètes. Lorsque Coca Cola annonce qu’il va ouvrir des épiceries solidaires Coca Vola, que faut-il en penser ? Et faut-il se priver de l’aide de la Fondation Gates, pratiquement le plus grand intervenant humanitaire au monde (voir encadré), sous prétexte qu’on n’aime pas les pratiques commerciales de Microsoft ? Jusqu’où « vendre l’image des ONG » en l’associant à telle ou telle entreprise ? Autant de questions à trancher par les comités d’éthique qui se sont créés un peu partout…
Par ailleurs, pour pouvoir organiser sur le terrain le soutien à la population, il faut identifier les bénéficiaires et les répertorier, ce qui requiert un vrai savoir-faire. Dans un camp de réfugiés, les gens ont tout perdu, à commencer par leurs papiers d’identité, quand ils en avaient, et les réseaux de trafiquants ou les milices antagoniques se mettent en place très rapidement. Les opérations de distribution de nourriture peuvent vite tourner à la foire d’empoigne, au racket, voire aux batailles rangées. À la campagne, quand il n’y a plus rien à manger, on ne se trompe guère en nourrissant pratiquement tout le monde. Mais en ville, comment faire la distinction entre le pauvre absolu, qui n’a vraiment rien et se trouve en danger de mort, et son voisin, en haillons également, mais qui de fait peut plus ou moins subvenir à ses besoins, de façon à ne pas trop disperser les ressources limitées dont on dispose ?
Une fois les gens répertoriés, il convient de mettre en place des systèmes de transfert de fonds sécurisés, comme par exemple ceux passant par des cartes de crédit ou des téléphones portables (voir chapitre précédent). C’est une tâche très compliquée lorsqu’on doit l’accomplir au milieu du désordre absolu provoqué par la catastrophe, mais absolument nécessaire, puisque l’alternative, la distribution directe de nourriture à un grand nombre de personnes (si possible avec un plat chaud) se révèle en général encore plus chaotique.
Les organisations capables d’intervenir en urgence à l’autre bout du monde sont peu nombreuses. En France, on connaît les plus grandes ONG : Médecins sans frontières, Médecins du monde, Action contre la faim, mais aussi Solidarités International ou la Croix-Rouge (voir chapitre suivant). Dans un deuxième temps et de façon plus spécialisée, on retrouvera Handicap International, Architectes de l’urgence, etc. Et l’État lui-même, qui envoie par exemple régulièrement des pompiers formés spécialement pour ce type de fonction. L’équivalent existe dans la plupart des pays occidentaux. À l’échelle internationale, on citera en tout premier lieu le Programme alimentaire mondial des Nations unies, qui achemine et fournit aux ONG une bonne partie de la nourriture que ces dernières distribuent sur le terrain.
Ensuite on entre dans le « temps long », toujours plus compliqué car les projecteurs se sont éteints : les journalistes sont partis et les donateurs regardent ailleurs. Mais à quoi bon avoir sauvé toutes ces vies si on laisse les gens dans un tel dénuement qu’ils en mourront à la longue ? En ville, il faut mettre en place des systèmes du type « nourriture contre travail », pour les réinsérer dans les circuits économiques. À la campagne, il faut redémarrer l’activité agricole : fournir des semences, des outils, des animaux, etc., à des paysans qui ont tout perdu, les aider à remettre en service les digues et canaux d’irrigation, leur assurer des secours alimentaires jusqu’à la première récolte. Partout, il faut reconstruire, soigner et rouvrir des voies de communication.
L’idéal est de bien se partager les tâches entre les ONG initialement présentes sur place pour éviter les doublons, puis d’assurer le « passage de témoin » entre les ONG d’urgence et celles de développement. Ce qui n’est malheureusement pas facile, tant leurs cultures sont différentes (et la concurrence entre elles pour les ressources publiques et privées bien réelle). Et enfin il faut organiser la prévention, pour éviter que la prochaine catastrophe ne soit pire encore. Par exemple dans les zones inondables, aider les habitants à construire sur pilotis, ou au moins à avoir un lit en hauteur plutôt qu’une natte à même le sol, ou encore un accès direct au toit de leur maison depuis l’intérieur pour pouvoir y grimper s’ils sont surpris par une brusque montée des eaux la nuit[4]. Et, bien entendu, installer des systèmes d’alerte et prépositionner des kits d’urgence prêts à partir. C’est aussi un nouveau métier pour les ONG.
[1] Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), Rapport annuel 2013, <www.unocha.org>.
[3] <www.agra.org>.
[4] Songeons que dans un pays riche et organisé comme la France, en Vendée, on a délivré des permis de construire sur des terrains inondables tout près de la mer, pour des maisons d’un seul niveau sans escalier permettant de monter sur le toit en cas de nécessité ; et ensuite on a négligé d’entretenir les digues et les systèmes d’alerte. Résultat : quarante-sept morts lors de la tempête Xynthia de février 2010, dont vingt-neuf à La Faute-sur-Mer. Alors imaginons ce qui peut se passer dans les pays presque sans État…
Pour le jeudi 11 septembre, anniversaire pour moi de la mort d’Allende qui a changé ma vie il y a 41 ans (j’ai fini par aller vivre au Mexique au lieu du Chili), des réflexions sur la nécessité de favoriser l’agriculture autour des villes, et à l’intérieur mêmes des villes (page 198 du livre)
Maintenir des campagnes vivantes et productives autour des villes
Les villes ont besoin d’être entourées de campagnes productives[1], et pas seulement de zones industrielles et parcs de loisirs, mais aussi de routes, d’aéroports ou de ports pour s’approvisionner au loin. Il est infiniment plus sûr de se ravitailler à moins de 500 km de chez soi et dans le même pays, qu’aux antipodes dans une contrée qui ne vous sera pas toujours forcément favorable et dont les priorités ne sont pas les vôtres. Observons que c’est exactement le contraire que préconisaient une bonne partie des experts internationaux avant la crise alimentaire de 2007 . Un développement agricole intensif est donc particulièrement important autour des grandes mégalopoles comme Mexico, Lagos ou Manille, mais aussi autour des quarante-six villes indiennes, des cent quarante-sept villes chinoises ou des cinquante-deux villes africaines dont la population dépassait le million d’habitants en 2011. Pourtant, reconstituer une agriculture efficace quand la société se passionne pour la modernité urbaine n’est pas simple, prend du temps et nécessite une véritable révolution culturelle tant les gens des villes ont pris l’habitude de mépriser les gens des champs.
Déjà, on devrait cesser de supprimer les terres agricoles. Gardons à l’esprit qu’un homme moyen engloutit une tonne de nourriture chaque année, dont un peu plus de la moitié en liquide. Si on arrondit la partie solide à 400 kg par personne et par an (un peu plus d’un kilo par jour) une agglomération d’un million de personnes (par exemple Lyon, Marseille ou Bruxelles) a besoin de s’approvisionner avec 400 000 tonnes de nourriture annuelle, soit 600 000 à 700 000 tonnes au total, épluchures et gâchis compris. Et plus d’un million de tonnes si l’on compte tous les végétaux qui ont été préalablement transformés en viande, œuf et lait. Ce qui nécessite de cultiver plusieurs centaines de km2, soit au moins l’équivalent de la propre superficie de la ville concernée, uniquement en champs cultivés ; et en prenant en compte les rivières, routes, villages, forêts, etc., il faut multiplier cette superficie par deux. Selon la productivité de l’agriculture locale, une ville doit donc disposer d’au moins deux à cinq fois sa superficie en campagne, dont la production lui est entièrement consacrée.
Or justement, autour des villes, on ne cesse de préempter les terres pour des usages périurbains (transport, commerce, industrie, loisirs). En France, où l’on possède déjà le nécessaire et le superflu, on continue à bétonner, goudronner ou neutraliser l’équivalent en superficie agricole d’un département tous les sept ans. Est-il absolument indispensable de continuer à y favoriser la maison individuelle, avec des superficies de terrains croissant exponentiellement dès qu’on s’éloigne un peu des villes, les résidences secondaires encore plus étendues, ou d’y construire cinq cents nouveaux ronds-points par an alors qu’on en compte déjà plus de 30 000 (six fois plus qu’en Allemagne) ? Dans le monde, la perte serait de l’ordre de 100 000 km2 par an, soit l’équivalent du tiers de la surface agricole utile française. De ce fait, malgré la célérité avec laquelle on défriche les forêts tropicales, aggravant au passage le réchauffement de la planète, on cultive chaque année moins de terre. On goudronne, bâtit, pollue, érode ou désertifie davantage qu’on ne défriche. Si l’on divise les surfaces cultivées (exception faite des pâturages) par la population mondiale, chaque humain disposait d’un demi-hectare en 1960. Il n’en avait plus qu’un quart en 2010 et n’en aura qu’un sixième en 2050. Il ne sera pas si facile alors de sortir 6 000 repas[2] de chaque hectare cultivé sur la planète, sans exception aucune…
Pour pouvoir nourrir les villes de demain, il faut donc arrêter l’hémorragie mondiale de terre arable, particulièrement dans les pays surpeuplés, où on a certes besoin de construire, mais tout autant de manger. Sans compter que les zones maraîchères qui se développent autour des villes, et qui ont déjà du mal à subsister vu la spéculation sur les terrains, exercent leur activité dans une atmosphère fortement polluée, en bordure d’autoroutes, d’aéroports, d’usines, d’incinérateurs d’ordures, etc. Les légumes y ont donc de bonnes chances d’absorber des métaux lourds et les dioxines.
Installer davantage d’agriculture en ville
Une autre perspective est d’utiliser au maximum le moindre mètre carré urbain[3]. La plupart des villes, africaines en particulier, sont encore relativement étendues et peu denses. Il y reste beaucoup d’espaces disponibles pour faire du maraichage intensif, voire un peu d’élevage de volailles ou de lapins, nourris pour l’essentiel avec les restes alimentaires de la famille : les toits en terrasse, les arrière-cours, les balcons, les parcelles non construites et autres réserves foncières, les rives des fleuves, les zones inondables[4], sous les lignes électriques. Mais aussi tout simplement les bords des rues, avec de simples sacs de récupération ou des pneus remplis de terre le long des maisons (posés sur une étagère à 1,5 m du sol pour ne pas attirer les insectes du sol ou les poulets). Voire certaines décharges et sites de traitement des déchets industriels…
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) estime que 800 millions d’individus pratiquaient en 2012 l’agriculture urbaine, assurant 15 % à 20 % de la production mondiale de nourriture. Beaucoup d’entre eux vivent en Asie, où la culture agricole citadine existe depuis longtemps, mais aussi en Amérique latine (probablement 230 millions de personnes). En Afrique, la FAO estime que 130 millions de citadins sont d’ores et déjà concernés. Par exemple à Kigali (Rwanda), 15 000 ha ont été réservés à l’agriculture et aux zones humides. Lagos (Nigéria) disposerait de 4 400 ha. D’autres estimations avancent le chiffre de 40 % des citadins africains prenant part à une forme d’activité agricole, dont la production d’aliments de base, de légumes, de fruits, de lait, d’œufs, de viande et de poisson. En Égypte, les nombreux avantages des jardins sur les toits sont bien documentés. Au-delà de fournir une alimentation bon marché et, très souvent, une source de revenu, ils peuvent diminuer la pollution de l’air, absorber la chaleur et avoir un effet isolant : 7 °C de moins dans les maisons concernées.
Parmi les bidonvilles de Nairobi au Kénya, celui de Kibera (un million d’habitant, probablement le plus grand d’Afrique) est depuis 2008 le théâtre d’une fructueuse expérience : l’ONG française Solidarités International y fait pousser de petits jardins potagers abrités dans des sacs de 1,20 m de haut remplis de terre et pierre et économes en eau[5]. Les familles les plus modestes y cultivent des choux ou des épinards, légumes à très forte capacité nutritive, notamment pour leur apport en fer ; en cinq ans, ces jardinières en sac ont contribué à améliorer l’alimentation de 225 000 personnes. À Johannesburg (Afrique du Sud), l’ONG Tlhago a fondé en 2011 une coopérative qui projetait de mettre en culture soixante-dix terrasses d’immeubles, espérant pouvoir nourrir cinquante personnes toute l’année avec chaque toit ainsi utilisé[6].
Le principal obstacle au développement de l’agriculture urbaine est sans doute la culture des élites dirigeantes et, d’une manière générale, des urbains aisés. Pour ceux qui n’ont aucun souci financier, le développement d’une ville est synonyme d’ordre, de propreté et d’embellissement, sous forme de beaux immeubles, de façades repeintes et de jardins publics aux vastes pelouses bordées de fleurs ; et peu importe la présence de taudis et de misère derrière, dès lors qu’ils sont cachés. Or les espaces dédiés à la production de légumes et de fruits, a fortiori de petits animaux, dérangent cette vision[7], car ils évoquent le désordre et le négligé. Il faut donc une vraie évolution culturelle pour admettre qu’une belle ville est d’abord une ville où chacun peut manger à sa faim, objectif plus aisément atteignable si la nourriture est produite sur place. D’autant plus que ces espaces de production renforcent la vie communautaire et finissent par mieux assurer la sécurité qu’une nouvelle caserne de policiers. C’est par exemple ce qu’ont vécu les Cubains quand leur système de production agricole et d’importation de nourriture s’est brutalement effondré avec la chute du communisme européen ; y produire du sucre dans de grandes exploitations bureaucratisées pour le vendre aux Russes et importer de la nourriture avec l’argent ainsi gagné est vite apparu… peu durable. Et le recours à l’agroécologie urbaine s’est imposé de lui-même (voir encadré ci-après). Les villes africaines constitueront dans les prochaines décennies un enjeu crucial dans ce domaine. Après avoir envoyé sur ce continent des conseillers militaires et des médecins, verra-t-on Cuba y placer des agroécologues urbains ?
[1] Les grandes métropoles historiques ont eu des politiques spécifiques dans ce sens. Paris a toujours cherché à moderniser l’agriculture du Bassin parisien et des régions limitrophes (comme le Centre et la Normandie), et a construit à ses portes, à Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. New York s’est offert le canal Erié dès 1825, une voie d’eau de 584 km en direction des grands lacs et du Middle West agricole. Londres regardait pour sa part le grand large et comptait sur son port et sur le Commonwealth pour entretenir ses stocks.
[2] Si l’on souhaite que chacun mange trois fois par jour, 365 jours par an, il faut produire plus 1 000 repas par an et par personne.
[3] Dans les pays développés, c’est quand les banlieusards arrachent leurs rosiers pour planter des pommes de terre que l’on peut mesurer l’ampleur de la crise économique – on a observé le phénomène à Athènes au début des années 2010. Pendant le siège de Leningrad (Saint-Pétersbourg), de 1941 à 1944, qui causa plus de 600 000 morts de faim, tous les espaces disponibles sans exception, rues, places, etc., étaient dévolus au maraichage.
[4] Le mot « maraîchage » provient de la pratique ancienne de cultiver des légumes dans les zones marécageuses peu constructibles.
[5] Solidarités International, « Kenya reportages : les fleurs de Kibera », 12 septembre 2011, <http://ur1.ca/h71v8> ; et Sophie Landrin, « Cultiver des légumes dans les bidonvilles pour nourrir l’Afrique », Le Monde, 4 septembre 2012.
[6] On a évalué à seulement 300 hectares la surface de toits cultivables de Paris, ville très dense et qui possède peu de terrasses. Dans d’autres villes du Sud, les surfaces sont loin d’être anecdotiques.
[7] L’auteur a vécu personnellement cette « autre manière de voir la ville » lorsqu’il a quitté sa maison de San Luis de la Paz au Mexique, laissant un joli petit jardin d’agrément dans la cour attenante, pour voir aussitôt son successeur y installer poules et cochon.
Pour le mercredi 10 septembre, la politique « FAIM ZÉRO » du Brésil, qui a motivé l’écriture de ce livre et lui a donné son titre (page 182 du livre)
La politique « faim zéro » pionnière du Brésil…
Le Brésil a montré en ce sens une voie vraiment nouvelle pour le xxie siècle. Quand on y réfléchit, il est d’ailleurs incroyable qu’il ait fallu attendre 2003 pour que le gouvernement d’une grande puissance agricole avoue officiellement que la faim y était un problème et se soit engagé à le résoudre. Après des décennies de dictatures militaires et de pouvoirs corrompus, l’occasion historique a été apportée par l’élection à la présidence d’un leader syndicaliste, Luiz Ignacio « Lula » da Silva. Lorsqu’il arrive au pouvoir en 2003, 70 millions de Brésiliens sont en état d’insécurité alimentaire, soit plus du tiers de la population, ce qui n’empêche pas ce pays d’être le premier exportateur mondial de soja, café, sucre, jus d’orange et viande. On y avait faim à l’ombre des cannes à sucre, comme l’avait déjà observé Robert Linhart dans les années 1970[1].
Lula et son équipe ont trouvé un mot d’ordre simple et puissant : « Faim zéro ». Et il a annoncé dans son discours d’intronisation : « Si, à l’issue de mon mandat, chaque Brésilien mange trois fois par jour, j’aurai accompli la mission de ma vie. » Les observateurs européens ont tous parié alors qu’il allait pour ce faire engager une réforme agraire : exproprier les grands propriétaires « latifundistes » pour donner les terres aux petits paysans regroupés en coopératives[2] – ce qui avait été tenté par le passé dans plusieurs pays d’Amérique latine, du Mexique de Lazaro Cardenas au Chili de Salvador Allende, sans parler du Cuba de Fidel Castro. D’autant plus que s’était affirmé au Brésil un important Mouvement de paysans sans terre (MST), bénéficiant d’un important soutien international. À la surprise générale, il n’en fut rien. Lui-même syndicaliste issu de la grande industrie, Lula estimait que les grandes exploitations agricoles qui exportaient et rapportaient des devises étaient indispensables au développement de son pays. Prenant les ONG et les militants de gauche à contre-pied, il a commencé par réinventer les allocations familiales, constatant que la faim n’était pas due dans son pays à un déficit de production, mais à l’absence de revenus dans les classes populaires. Profitant à fond de l’ère numérique, il a réussi à faire converger ces fonds sur les seuls achats alimentaires, tout en assortissant leurs paiements de conditions, comme la présence des enfants à l’école. Et, surtout, il a réussi à organiser une véritable mobilisation nationale allant dans ce sens, non seulement du secteur agricole, mais de l’ensemble des ministères et de la société civile, les représentants des plus pauvres pouvant alors intervenir directement sur les politiques mises en œuvre et contrôler leur application.
Le programme Faim Zéro brésilien : « Le Brésil qui mange aide le Brésil qui a faim »
Il s’agit d’un ensemble de mesures coordonnées par un « ministère du Développement social et du Combat contre la faim », qui pilote une « Chambre interministérielle de sécurité alimentaire et nutritionnelle » à laquelle participent dix-neuf ministères, et par une institution dans laquelle la société civile est majoritaire : le « Conseil national de sécurité alimentaire et nutritionnelle ». On y trouve :
– un système d’allocations familiales, la bolsa familia : 40 euros en moyenne sont versés chaque mois aux femmes dont les enfants vont à l’école et sont suivis médicalement (environ 48 millions de bénéficiaires), sur une carte de crédit spéciale qui ne peut servir qu’à acheter des produits alimentaires. Cet argent a permis d’amener des fonds dans les plus petits villages, ce qui a redynamisé le commerce local. L’État consacre 2 % de son budget à cette bolsa familia, soit environ 6 milliards d’euros ;
– un programme de renforcement de l’agriculture familiale via le crédit et l’assurance, le PRONAF : bonification des taux d’intérêt des prêts pour les agriculteurs familiaux sous condition de revenus. En 2009-2010, 2,2 millions d’agriculteurs en ont bénéficié ; 60 % est orienté vers les petits paysans pauvres et 70 % pour des crédits inférieurs à 120 000 euros ;
– un programme d’achat public de produits alimentaires, le PAA : la Compagnie nationale d’offre alimentaire achète des produits alimentaires aux agriculteurs familiaux pour les fournir aux programmes de facilitation de l’accès à l’alimentation. Ces achats étatiques sont bonifiés de 30 % pour les productions issues de l’agroécologie, afin d’encourager ce type d’agriculture, et plafonnés pour chaque agriculteur, afin de profiter au plus grand nombre ;
– un programme d’alimentation scolaire, le PNAE, qui fournit aux élèves des établissements publics un repas gratuit, sain et adapté aux habitudes et traditions alimentaires, constitué d’au moins 30 % de denrées issues de l’agriculture familiale locale achetées via le PAA. En 2010, 160 000 agriculteurs ont livré le PAA pour nourrir 17 millions de personnes ;
– d’autres instruments concernent la gestion des risques (assurances), la régulation de certains prix, des dispositifs de formation professionnelle et de renforcement des capacités des acteurs, des systèmes de contrôle sur la qualité nutritionnelle, les banques alimentaires, l’agriculture urbaine, etc.
Ce programme a eu un succès considérable. Il a permis à 20 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté entre 1999 et 2009 (passant de 28 % à 10 % de la population), réduit la malnutrition infantile de 61 %, la mortalité infantile de 45 % et la pauvreté rurale de 15 %, en favorisant l’agriculture locale et la consommation de produits locaux. Le Brésil est devenu une référence internationale en matière de sécurité alimentaire. Ces résultats n’ont pas été étrangers au fait qu’après deux mandats, Lula soit l’un des seuls dirigeants politiques de la planète à avoir gardé une popularité incroyable en temps de crise et que son adjointe Dilma Rousseff ait été élue aisément à son tour. Les contestations dont elle a fait l’objet en 2013 ne sont d’ailleurs pas venues des bidonvilles, mais des classes moyennes, qui ne se trouvaient pas assez bénéficiaires du développement du pays…
Cette politique exemplaire démontre à nouveau que, sauf cas extrême du type catastrophe naturelle, éradiquer la faim, ce n’est pas d’abord le problème des paysans, des ONG, de l’aide internationale ou des fournisseurs de semences, d’engrais ou de matériel agricole. Cela consiste avant tout à mettre en œuvre une véritable organisation nationale d’accès à la nourriture. Redisons-le, la faim est politique, son éradication aussi. Cette idée simple commence à se répandre : le défi « faim zéro » a été officiellement lancé au niveau mondial par le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon en juin 2012, lors de la Conférence sur le développement durable Rio +20. Son ancien promoteur brésilien, José Graziano da Silva, devenu directeur général de la FAO en 2011, déclarait en avril 2013 : « C’est principalement au gouvernement d’un pays qu’incombe la sécurité alimentaire de ses ressortissants : les Objectifs du millénaire pour le développement nous ont beaucoup fait progresser. Mais 870 millions de personnes souffrent toujours de la faim, aussi la guerre contre l’insécurité alimentaire est-elle loin d’être terminée. La seule réponse efficace à l’insécurité alimentaire reste l’engagement politique au niveau national, renforcé aux échelons régional et mondial par la communauté internationale des donateurs et les organisations internationales. Le droit à l’alimentation dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale est désormais une base de discussion acceptée dans le monde entier. »
[1] Robert Linhart, Le Sucre et la Faim, op. cit.
[2] En 2010, 1 % seulement des exploitations agricoles avaient plus de 1 000 hectares, mais elles concentraient 43 % de la surface agricole du pays ; trois cents propriétaires possédaient 40 millions d’hectares et 5 % des exploitations produisaient 80 % de la production agricole nationale.
Pour le mardi 9 septembre, une invitation à garder son sang froid et ne pas penser, comme souvent les européens, que la technologie peut résoudre les problèmes de la faim (page 158 du livre). On y voit que la construction d’un puits peut parfois augmenter la faim dans une région aride !
S’occuper du social et de l’éducatif avant de diffuser des techniques
On rencontre régulièrement des Européens qui entendent promouvoir telle ou telle technologie susceptible de contribuer efficacement, selon eux, à résoudre le problème de la faim. Ils cherchent alors des financements pour diffuser massivement ces techniques. Parfois, les organisations internationales, les gouvernements locaux, voire les ONG se laissent prendre au jeu. On lance alors des programmes de construction de puits ou de mares, d’élevage (volailles ou chèvres, poissons, voire insectes), de maraichage, d’arboriculture, de stockage (entrepôts pour les céréales et les légumes, tanks à lait réfrigérés à énergie solaire), et bientôt d’agriculture écologiquement intensive (sans labour, agroforesterie, associations de plantes), etc. Les financeurs, qui n’imaginent même pas la vie sans eau, sans viande et sans légumes, sans possibilité de stockage, se rassurent et se donnent bonne conscience. Eux n’iraient certainement pas se fourvoyer, comme paraît-il certains Russes au siècle dernier, en envoyant des chasse-neiges dans les pays tropicaux ! Dans leur esprit, ces techniques sont bonnes et utiles, donc les diffuser ne peut qu’aller dans le bons sens.
Prenons l’exemple d’un puits. La question simple : « La construction d’un puits permet-elle de diminuer la faim dans un village ? » peut paraître saugrenue à un esprit occidental choqué par la dure vie de ceux (et surtout celles) qui doivent tous les jours marcher sur plusieurs kilomètres pour ramener quelques bidons d’eau à la potabilité douteuse. Mais la construction d’un « vrai » puits entraîne irrémédiablement l’arrivée dans le village de technologies jusque-là non maîtrisées et d’une monétarisation de la vie économique. Même si le coût du forage et de la pompe est subventionné, il faut s’endetter pour payer l’entretien de celle-ci, puis rembourser ou payer un droit d’utilisation de l’eau, ce qui devient difficile pour ceux qui vivent dans la simple subsistance. Ils doivent donc commencer à vendre une partie de leur récolte et abandonner les cultures vivrières, dont le marché est peu organisé, au profit de cultures d’exportation (thé, café, cacao, arachide, coton, etc.), pour lesquelles on trouve des acheteurs sur place, mais sans aucune maîtrise des prix. Parfois, ils partiront travailler quelques semaines ou quelques mois ailleurs pour compléter les revenus. Très rapidement, le « marché » fait le tri entre ceux qui sont alphabétisés et instruits, qui savent déjà se débrouiller dans la ville voisine, qui parlent la langue des affaires ou des urbains, anglais, français ou espagnol, qui ont un petit pécule… et les autres, qui ne sont absolument pas préparés à cette irruption du modernisme.
Au bout de quelques mois, au plus quelques années, l’apparente égalité entre les villageois est remise en question. À la première mauvaise récolte, ou baisse du cours de leur production, les plus pauvres finissent par céder leur lopin de terre aux plus riches et deviennent ouvriers agricoles ; ils se sont prolétarisés dans un marché de l’emploi qui ne leur est absolument pas favorable[1]. Et fatalement, ils finissent par ne plus pouvoir suffisamment se nourrir et se voient obligés d’immigrer. La boucle est bouclée : le puits a finalement fait progresser la faim dans le village, tandis que l’irrigation qu’il permet augmente la production alimentaire industrielle… à destination des villes. Celles du pays concerné dans le meilleurs cas, des villes européennes ou nord-américaines dans les autres, vers lesquelles se déversera à bas prix cette monoproduction de produits tropicaux ou de contre-saison. L’enfer est ainsi pavé de bonnes intentions et c’est pourquoi certains programmes de développement refusent de se lancer dans la construction de puits quand les conditions ne sont pas réunies pour éviter tous ces effets pervers.
Car le principal obstacle à la sortie du sous-développement, qui contribue à reproduire mécaniquement l’insécurité alimentaire, est d’abord la grande difficulté des exclus à se projeter dans un avenir différent et à entreprendre ensemble. La solution de ce problème ne peut être purement technique : une stratégie efficace doit être avant tout sociale et éducative. Là encore, si l’origine de la faim est politique, son éradication l’est tout autant. Les technologies peuvent éventuellement appuyer des stratégies sociales, mais à la limite, peu importe que l’on commence par des actions agricoles, alimentaires, hydrauliques, énergétiques ou hygiénistes. Le plus important et de savoir comment et avec qui on les mène. La technique est un prétexte à l’action éducative et sociale, et non l’inverse. D’autant plus que, dans les villages très pauvres, on a d’abord besoin de processus élémentaires et non de haute technologie ni de techniques coûteuses en capital. Pour se faire financer, les programmes d’aide les plus responsables recourent donc souvent à une certaine hypocrisie : ils recueillent de l’argent pour diffuser des techniques, en expliquant que, pour qu’elles soient efficaces, il faut bien conduire en même temps des actions d’éducation et de structuration sociale. Alors que leur vraie stratégie est inverse : faire de l’éducation-conscientisation et de la structuration sociale, en partant des techniques nouvelles que les financeurs veulent bien soutenir ; comme elles importent peu en pratique, autant mobiliser celles qui plaisent aux financeurs.
D’où la question : comment faire évoluer les mentalités et introduire l’envie de changer et d’entreprendre au sein même des cultures locales, de surcroît de façon solidaire ? Elle se pose de façon particulièrement aiguë pour les ONG des pays du Nord dont les cultures d’origine de leurs dirigeants et expatriés sont étrangères à celles des populations des pays du Sud qu’ils veulent aider. Beaucoup d’argent a été dépensé en vain du fait de cette incompréhension culturelle, beaucoup de jeunes expatriés européens sont revenus désabusés, parfois racistes, après avoir échoué dans leur mission, faute d’avoir pu s’intégrer dans une dynamique locale. La plupart des ONG de développement en ont pris conscience et n’envoient plus d’expatriés, privilégiant désormais le soutien aux associations locales. Parfois, vues de Paris, Londres ou La Haye, certaines d’entre elles peuvent paraître lentes, timorées ou bureaucratiques, mais elles savent certainement mieux dialoguer avec les agriculteurs pour initier un changement respectueux de leur culture ; et sont donc mieux à même de poursuivre leurs actions pendant de nombreuses années, quitte à solliciter l’envoi d’experts occidentaux pour de courtes missions d’appui technique lorsque c’est nécessaire.
Les ONG d’urgence du Nord sont a priori moins confrontées à ce problème, puisqu’elles n’interviennent en général que pour des périodes plus courtes et dans des situations où les associations locales du Sud sont devenues relativement impuissantes. Elles continuent donc à envoyer médecins, infirmières, nutritionnistes, logisticiens, etc., qui apportent ainsi un soutien décisif à des millions d’humains soumis aux pires détresses. Mais ce faisant, elles courent également le risque d’induire découragement et aliénation en démontrant aux populations assistées qu’elles ne peuvent décidemment pas s’en tirer seules… D’où l’importance pour les responsables de ces ONG du Nord de s’obstiner à rechercher l’appui des structures du Sud – ce dont ils sont pour la plupart devenus très conscients –, en gardant la suite à l’esprit : chaque vie sauvée implique de savoir comment produire ensuite localement pour elle 400 à 500 kg de nourriture par an, en moyenne 30 tonnes sur toute une vie.
[1] Une anecdote vécue pour montrer jusqu’où cela peut aller sur le terrain : dans les années 1970 au Mexique, dans le nord de l’État de Guanajuato, certains agriculteurs ont creusé des puits profonds pour irriguer leurs plantations de roses et de fraises d’exportation vers les États-Unis. Ces puits ont asséché les puits superficiels de leurs voisins villageois (la nappe phréatique superficielle s’est vidée dans la nappe plus profonde). Pour boire, il ne restait plus qu’à prélever dans les canalettes d’irrigation, ce que le propriétaire interdisait formellement à tous ceux qui n’étaient pas salariés chez lui, de façon à « régler le problème social » en assoiffant tous ceux qui n’acceptaient pas de devenir ses employés pour les faire fuir…
Pour le lundi 8 septembre, je vous propose l’introduction au chapitre 5 sur les limites des OGM et de la Révolution verte, alors qu’il faut trouver de nouvelles voies pour encore augmenter de 70 % la production agricole mondiale (page 109 du livre, sans les tableaux de chiffres)
Pour atteindre l’autosuffisance alimentaire de tous les humains, le chemin restant à suivre à partir des années 2010 est à première vue beaucoup moins escarpé et ambitieux que celui déjà parcouru lors des quatre décennies précédentes. Les productions végétales ont pour la plupart crû de bien plus de 70 % de 1970 à 2010[1]. Ainsi, les quantités produites de blé, de riz et de manioc ont plus que doublé, celles de maïs ont triplé et celles de soja ont été multipliées par six (voir tableau ci-après), même si la production de pommes de terre est restée stable (mais c’est surtout parce que les pays qui en mangeaient beaucoup, en particulier européens, ont nettement diminué leur consommation).
En quarante ans, la spectaculaire croissance de la production agricole mondiale
On peut observer les performances de la Chine, premier producteur mondial de blé, de riz et de pommes de terre, deuxième de maïs. La croissance spectaculaire de son agriculture en quarante ans constitue objectivement un signe d’espoir pour nombre d’autres pays. Elle a su tirer les leçons de ses échecs lors des collectivisations forcées du temps de Mao et trouver les voies d’une agriculture extrêmement efficace. Comme on l’a vu, les résultats de l’Inde, également réels, sont moins spectaculaires et, surtout, très insuffisants.
En matière de produits animaux, la croissance a également été impressionnante. Les classes moyennes du monde entier, en plein développement, en consomment de plus en plus et la production a suivi : celle de volaille a été multipliée par sept et celle des œufs par trois ; celle de porc a également triplé, celle de bœuf a augmenté de 68 % et celle de lait de 67 % (rappelons là encore qu’on consomme très peu de lait en Chine et très peu de viande en Inde). Ces animaux absorbent une bonne part des gains de production de blé, de maïs et de soja, assez souvent au détriment de la diète des plus pauvres, qui ont vu le prix de leurs aliments de base augmenter au-delà de ce qu’ils pouvaient financer. On trouvera également en annexe des chiffres concernant la croissance d’autres produits alimentaires : la production de sucre a plus que doublé et celle d’huile de palme a été multipliée par quinze (pour ces deux produits, une part non négligeable sert à faire des carburants), et on a observé un quadruplement pour le thé, les fruits et les légumes et un doublement pour le café.
Un autre indicateur du progrès accompli est l’évolution des rendements moyens à l’hectare – moyen, car le rendement d’un même champ peut beaucoup varier d’une année sur l’autre en fonction des conditions climatiques. Dans la période 1970-2010, celui du blé a doublé, passant de 15 à 30 quintaux[3] à l’hectare au niveau mondial (de 34 à 69 quintaux en France et de 11 à 47 en Chine). Idem pour le riz, qui est passé en moyenne mondiale de 23 à 43 quintaux (de 34 à 65 quintaux en Chine). En France, un m2 de champ de blé produisait en 2010 de quoi fabriquer quatre baguettes de pain, contre une seule un siècle plus tôt[2] ; et une vache laitière donnait en moyenne près de 7 000 litres de lait par an (un peu plus de 20 litres par jour pendant dix mois, soit quatre à cinq fois plus que ce dont son veau a besoin pour vivre) ; certaines dépassaient les 10 000 litres. Quarante ans auparavant, on se satisfaisait d’atteindre 3 000 à 4 000 litres, ce qui est encore le cas dans bien des pays.
Ces évolutions semblent donc relativement encourageantes : la « révolution verte » ayant ainsi réalisé des miracles dans de nombreux pays à la fin du dernier siècle, une autre ne pourrait-elle faire de même au début du xxie siècle ? Justement, non ! Car s’il est relativement facile de s’améliorer quand on n’est pas encore performant, une fois ces améliorations acquises, les progrès sont plus difficiles et plus lents : extraire 10 quintaux supplémentaires de céréales d’un hectare est beaucoup plus facile quand on n’en produit que 20 que quand on en produit déjà 80. De plus, les progrès accomplis l’ont été dans une période où l’on pouvait aisément disposer de nombreuses ressources non renouvelables ; on a produit « plus avec plus ». Or on est désormais arrivé aux limites des ressources de la planète et il faut apprendre à produire « plus avec moins », ce qui est beaucoup moins évident. D’autant plus que les retombées négatives de cette « industrialisation de l’agriculture » sont devenues de plus en plus sévères.
[1] Source : FAOSTAT. 30 quintaux font 3 tonnes (dans l’agriculture, on continue à évaluer les rendements en quintaux, « à l’ancienne »).
[2] L’économie moderne du blé en France est la suivante : on sème 220 grains de blé au m2, 100 kg à l’hectare, pour en récolter quatre-vingt-dix fois plus, soit 9 tonnes, qui donneront 7 tonnes de farine, permettant de faire 38 000 baguettes.
[3] Source : FAOSTAT, <http://ur1.ca/gxejh>.
Pour le samedi et le dimanche 6 et 7 septembre, évoquons ce paradoxe que ce ne sont pas toujours les pays les plus riches où l’on mange le mieux, loin s’en faut (page 71 du livre)
Les pays pétroliers et miniers sont souvent des pays de la faim
Quand on habite un État faible et corrompu, la découverte de gisements miniers ou pétroliers se révèle singulièrement néfaste pour les habitants, car elle excite les appétits les plus violents, internes et externes, et finit par désorganiser le pays, voire par y semer la guerre, financée par des intérêts économiques. Au total, la population trinque ; on y a faim sur un tas d’or.
C’est ce qu’illustre par exemple l’histoire – romancée par Blaise Cendrars[1] – de Johan August Sutter, un aventurier suisse qui avait amassé une fortune considérable entre 1839 et 1848 en Californie, fondée sur l’agriculture et la petite industrie. En 1848, il possédait 20 000 hectares et 12 000 têtes de bétail… et on découvre de l’or dans sa propriété. S’ensuit une véritable ruée, qui détruit tout sur son passage et à laquelle il ne peut s’opposer, en l’absence d’État fort sur place. On y a compté jusqu’à 300 000 chercheurs d’or, qui avaient effectué préalablement un voyage périlleux de plusieurs mois via le cap Horn, ou à pied à travers l’isthme de Panama, et espéraient faire fortune. Sutter mourra ruiné ; ses ouvriers le désertèrent, ses droits de propriété furent contestés, ses récoltes ravagées, son bétail volé, sa maison incendiée et ses terres squattées par les nouveaux arrivants. Toujours pour l’appât du gain, les Amérindiens et les premiers colons furent attaqués et chassés de leurs terres, des tensions raciales et ethniques surgirent et l’extraction de l’or développa de multiples pollutions.
Cet exemple extrême s’est répété à l’infini à travers le monde. Pour les hydrocarbures par exemple : il faut habiter dans un pays riche et déjà très organisé pour que tous en profitent. C’est le cas par exemple en Norvège, où le niveau de vie de la population a été fortement accru par la découverte de gisements importants à la fin des années 1960. D’après l’Agence internationale de l’énergie, le pétrole et le gaz y apportaient en 2011 22 % du produit intérieur et 47 % des exportations du pays ; et, cas exceptionnel, ils ont vraiment servi à conforter la démocratie et le bien-être de la population, qui jouit de la première place au classement mondial de l’IDH. Mais ailleurs, où sont le bonheur, la santé, le savoir, la richesse partagée entre tous dans les pays pétroliers du Sud ? Il y a tellement d’intérêts en jeu que l’on n’y trouve couramment guerres, dictatures, coups d’État et, souvent, le chômage, le désespoir et la faim. Comment expliquer par exemple que, malgré la richesse en hydrocarbures de son sous-sol, l’Algérie n’était en 2012 que 93e dans le classement IDH, à côté de la Tunisie, pays sans pétrole (qui est 94e) ? Que le Nigéria était 153e, pas mieux que ses voisins Cameroun et Bénin (150e et 166e) ? Que l’Angola était 148e, l’Irak 131e ? Les gisements de pétrole, cela a signifié pour l’Irak des guerres quasi ininterrompues depuis 1980 (environ 1 million de morts contre l’Iran, 500 000 contre les États-Unis), en Angola une guerre civile entre 1970 et 2002 (1 million de morts), au Nigéria/Biafra une guerre civile entre 1967 et 1970 qui a fait entre 1 et 2 millions de morts. En Algérie, la volonté d’accaparement par certains acteurs étatiques de la richesse pétrolière est un facteur important à l’origine de la guerre civile de 1992-1999, qui a fait 150 000 morts, 1,5 million de déplacés et 20 milliards de dollars de dégâts.
La République démocratique du Congo (ex-Zaïre, ex-Congo Belge) est tellement riche en minerais de toutes sortes qu’on a souvent qualifié son territoire d’« aberration géologique ». « On » y exploite d’importants gisements de diamants, or, étain, cuivre, bauxite, fer, manganèse, charbon, pétrole, ce qui ne l’empêchait pas d’être en 2012 l’un des pays les plus pauvres du monde, à l’avant-dernier rang (186e) pour l’IDH, avec 87 % de la population qui vit en-dessous du seuil de pauvreté de 1,25 dollars/jour. Il faut dire que, depuis l’indépendance de 1960, les guerres civiles ont été quasiment ininterrompues et y auraient fait, rien qu’entre 1998 et 2004, 4 millions de morts. On y pratique l’enrôlement de force des enfants soldats et les viols de masse. Développer une agriculture dans ces conditions est impossible et c’est l’un des pays où l’on a le plus faim dans le monde. Pourtant, la RDC pourrait être une des plus grandes puissances agricoles mondiales et un concurrent majeur du Brésil, car son potentiel, sur une superficie équivalente à quatre fois la France, est exceptionnel. Faudra-t-il attendre que tous les gisements miniers soient épuisés pour que la population puisse commencer à se nourrir suffisamment ?
En Afrique du Sud, autre « aberration géologique », les importants gisements d’or, diamants, charbon, chrome, manganèse, platine ou nickel ont valu à sa population, entre autres, de connaître le régime d’apartheid jusqu’en 1991 ; malgré la démocratisation en cours depuis lors, ce pays dit le plus développé d’Afrique n’était en 2012 qu’au 123e rang en matière d’IDH. L’espérance de vie n’y était que de quarante-neuf ans, une des plus faibles de la planète. Pourtant, on peut y voir des zones de grande efficacité agricole et il dispose de deux fois la superficie de la France. Les Noirs continuent à y avoir faim à l’ombre des vignes des Blancs…
Finalement, si tout n’y est pas rose non plus, il vaut sans doute mieux vivre à Cuba (59e à l’IDH en 2012) ou au Costa Rica (62e), pays largement dépourvus de matières premières, mais qui, malgré tout, se débrouillent mieux que leur voisin grand producteur de pétrole le Venezuela (71e), même si ce dernier a fait beaucoup d’efforts dans les années 2000 pour faire mieux profiter son peuple des revenus qu’il en tire. Dans un monde ouvert, on le voit, la compétition entre les États et les grandes entreprises minières et pétrolières provoque de nombreux dégâts dans les pays où sont localisés les gisements. À tout prendre, mieux vaut pour le peuple ne pas se retrouver dans les griffes de cette implacable machine.
[1] Blaise Cendrars, L’Or, Gallimard, coll. « Folio », Paris, 1973 (première édition : Grasset, Paris, 1925).
On avait commencé le jeudi 4 septembre par ce chapitre de la « loi Parmentier », page 27 du livre :
Quel que soit le nombre de Terriens, 850 millions d’entre eux ont toujours faim
Dans l’histoire moderne, il semble qu’une fatalité fasse que, quelle que soit la taille de la population mondiale, on compte toujours entre 800 et 900 millions de gens qui ont faim. En 1900, la moitié des 1,8 milliard de Terriens souffrait de malnutrition – de façon certes schématique, on peut dire qu’on mangeait alors à sa faim chez les colonisateurs et qu’on avait faim chez les colonisés. En 1950, malgré les tragiques ponctions des deux guerres mondiales, la population mondiale avait gonflé de 1 milliard de personnes et on comptait toujours 800 millions d’affamés. C’est alors que la « fabrique d’humains » a tourné à fond, puisqu’elle a ajouté 3,5 milliards de personnes en cinquante ans, conduisant en l’an 2000 à 6,3 milliards d’habitants, dont 820 millions mal nourris. On comptait donc à peu près autant de personnes qui avaient faim sur Terre en 1900, 1950 et 2000.
En première approche, cette « loi » assez étrange peut être envisagée d’une manière encourageante : l’humanité a réussi à mieux nourrir ses membres, car depuis le début du xxe siècle, les mêmes champs ont permis de nourrir 5 milliards de personnes de plus. Tel est, en substance, le credo des organisations internationales, qui soulignent que le pourcentage d’affamés est passé de près de 50 % de la population mondiale en 1900 à 30 % dans les années 1950 et à 12,5 % au début des années 2010. La perception des organisations humanitaires est différente : pourquoi n’arrive-t-on pas à éradiquer la faim une bonne fois pour toute ? Puisqu’on a accompli de telles prouesses dans l’alimentation mondiale depuis le début du xxe siècle, comment se fait-il qu’on ne puisse pas atteindre ce but ultime ? Les 842 millions d’affamés de 2013 constituent une tache inacceptable dans notre monde et si on le voulait vraiment, avec les moyens dont nous disposons actuellement, il n’y aurait plus d’affamés sur cette planète.
À l’approche de l’an 2000, les Nations unies ont institué les « Objectifs du millénaire pour le développement »[1]. Il s’agissait, entre autres, non pas d’éradiquer la faim, mais de la diviser par deux. Dans l’euphorie du passage à un nouveau millénaire, les États membres se sont donc engagés à passer de 800 à 400 millions d’affamés d’ici 2015. Un objectif qui semblait raisonnable et à portée de main. Mais vraiment raté ! Le plus probable est en effet qu’en 2015, on comptera autant d’affamés qu’avant l’adoption des Objectifs du millénaire, voire plus. Vu l’échec, que faut-il envisager pour 2050 ? Se contenter d’une modeste progression en pourcentage ? Admettre que cela ne serait déjà pas si mal s’il n’y avait « que 850 millions » d’affamés, dans un monde de 9,7 milliards d’humains, donc « seulement » 9 % ? Nous verrons qu’il est parfaitement réaliste d’arriver à bien mieux que ça. Mais n’oublions pas que le pire pourrait aussi arriver : 1,5 ou 2 milliards d’affamés sur Terre en 2050, avec de ce fait de nombreuses régions en situation de guerre chronique…
[1] ONU, Objectifs du millénaire pour le développement et l’après-2015, <www.un.org/fr/millenniumgoals>.
—————————————————————————
Pour ce vendredi 5 septembre, observons les 15 pays qui seront les plus peuplés en 2050 (page 46 du livre, incluant un tableau)
La situation alimentaire des pays les plus peuplés à l’avenir
Regardons de près l’évolution démographique des quinze pays qui seront les plus peuplés de la planète en 2050, lesquels totaliseront probablement alors les deux tiers de la population mondiale (voir tableau suivant). Sur ce plan, le problème principal restera localisé dans la péninsule indo-pakistanaise, qui rassemble sur un territoire relativement exigu trois des pays les plus peuplés du monde (Inde, Pakistan et Bangladesh). Y nourrir 2,2 milliards de personnes en 2050 sur une surface deux fois plus petite que celle de la Chine (ou des États-Unis, ou du Brésil), occupée à raison de 524 habitants au km2 (montagnes, déserts et marais compris) tiendra du tour de force. Dans ce cas, la surpopulation constitue déjà – et constituera davantage à l’avenir – une cause directe de la faim. D’autant que, en 2012, les taux de fécondité y étaient encore élevés : 3,6 enfants par femme au Pakistan, 2,6 et 2,5 en Inde et au Bangladesh[1]. D’où notamment l’importance, dans ces pays comme ailleurs, d’éduquer les filles et de les aider à se faire respecter pour contribuer à la limitation des naissances – même si, on l’a vu, il ne s’agit que d’une des conditions nécessaires à la résorption de la faim.
En comparaison, la situation du continent africain semble plus favorable, car la densité moyenne de la population y est actuellement très faible (à peine 34 habitants au km2) ; celle-ci ne représente que les deux tiers de la population de la péninsule indo-pakistanaise, vivant sur un territoire sept fois plus étendu. Bien entendu, il faut compter avec l’immensité du Sahara et du Sahel en voie de désertification, mais l’Afrique subsaharienne est également fort peu peuplée. Que ces populations se développent au cours du xxie siècle est tout à fait logique et en aucune manière un scandale. Leurs problèmes sont ailleurs, comme on le verra dans les chapitres suivants, et les immensités africaines pourraient tout à fait nourrir les 2,3 milliards d’habitants annoncés pour 2050.
La République démocratique du Congo par exemple, dont la superficie atteint les deux tiers de celle de l’Inde, ne comptait en 2010 que 66 millions d’habitants, dix-huit fois moins. Avec une politique économique volontariste et cohérente, elle serait certainement en mesure de nourrir plusieurs centaines de millions de personnes ; les 182 millions prévues en 2050 ne la transformeront donc pas en un pays surpeuplé. À Madagascar, pays presque aussi grand que la France, il est profondément anormal de ne pas pouvoir nourrir les 20 millions d’habitants actuels, et techniquement rien ne devrait, en théorie, s’opposer à la satisfaction alimentaire des 55 millions d’habitants qu’on lui annonce pour 2050[2].
Il y a néanmoins quelques régions très peuplées en Afrique, où le problème se pose déjà de façon aiguë. En 2010, la moitié de la population était concentrée dans seulement cinq pays (Nigéria, Égypte, Éthiopie, Congo et Afrique du Sud), seuls les deux premiers ayant à faire face à une densité de population importante. L’Égypte est le trentième pays du monde pour la superficie et dispose d’un million de km2 ; de grandes surfaces donc, mais à 96 % désertiques. La superficie utile, celle qui permet de nourrir la population, est réduite à la seule vallée du Nil, où se concentrent déjà toutes les villes. Malgré une agriculture irriguée relativement efficace, l’Égypte n’arrive plus à nourrir elle-même sa population de 81 millions d’habitants depuis fort longtemps. C’est d’ailleurs année après année le plus grand importateur mondial de blé, et l’élévation des cours a eu et aura des conséquences très importantes sur les mouvements sociaux qui s’y déroulent. Du point de vue agronomique, il n’y a aucune chance que ce pays parvienne à nourrir à partir de ses terres (et surtout de son eau) les 126 millions d’habitants qu’on lui promet pour 2050. Il reste à espérer que ses voisins du nord de la Méditerranée continueront à produire des surplus pour les lui vendre – mais comment les paiera-t-il, surtout si les revenus du canal de Suez diminuent, les bateaux intercontinentaux préférant passer par le sud de l’Afrique ou bientôt le nord de la Russie ? Comme ses bailleurs de fonds, États-Unis et Arabie saoudite, pourraient finir par se lasser, il est malheureusement probable que l’Égypte soit condamnée à l’instabilité politique et aux régimes autoritaires, du fait de son incapacité durable à se nourrir lui-même.
Il existe quelques autres poches de surpopulation en Afrique, par exemple le Rwanda, qui ne dispose que de 26 338 km2 pour 11 millions d’habitants. Or il en est encore à un taux de 4,71 enfants par femme (et à une espérance de vie limitée à 58,8 ans). S’il atteint les 24 millions estimés pour 2050, la densité de population y sera critique, une des plus élevées de la planète (près de 1 000 habitants au km2). On peut donc considérer que les tensions, internes et externes, y resteront la règle au xxie siècle. Mais si le Rwanda est bien surpeuplé, tel n’est pas le cas des pays voisins (Tanzanie, Ouganda, Soudan, Congo) ; ce n’est pas à ce titre qu’ils sont pauvres et que le nombre de sous-alimentés y est important.
Sur un autre continent, on peut évoquer le cas du Guatemala, petit pays de 108 889 km2 qui comptait déjà 15 millions d’habitants en 2010[3] et qui devrait en avoir 32 millions en 2050. Sa densité moyenne sera alors de 290 habitants au km2 et il est peu probable que tous y mangent à leur faim. Il faudra donc espérer que le Brésil, qui aura, lui, une densité onze fois plus faible, pourra lui fournir un peu de nourriture. Mais là aussi, comment pourra-t-il la payer ? Remarquons que dans cette région de relative pauvreté, si le Guatemala est déjà surpeuplé, il n’en va pas de même du Honduras, ni du Costa Rica et du Nicaragua. L’urgence de développer les programmes de planification familiale est donc très variable d’un pays à l’autre. De même, on verra plus loin que la différence importante de niveau de vie entre Haïti et la République dominicaine ne vient pas d’un déséquilibre de population, car elle est identique, mais de l’absence d’État et de forêt en Haïti.
Il existe ainsi des régions du globe où la surpopulation menace vraiment la capacité des hommes à se nourrir. Mais dans bien d’autres régions, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique, les espaces sont encore immenses et très largement sous-peuplés par rapport à la moyenne des autres continents[4]. Bien sûr, il est illusoire de penser que des migrations de populations des premiers vers les seconds puissent constituer une solution. En revanche, tout au long du xxie siècle, le problème des « réfugiés climatiques » va se poser d’une façon dont on n’a pas encore idée. Rappelons que seize des vingt-cinq plus grandes villes du monde sont aujourd’hui situées au bord de la mer et seront directement menacées par l’élévation du niveau de la mer provoquée par le réchauffement climatique. Il s’agira probablement de centaines de millions de personnes, qui vont déstabiliser des régions entières et répandre les famines sur la planète. Actuellement, ces réfugiés climatiques n’ont aucun statut juridique, malgré les efforts des Nations unies et de diverses ONG, mais même quand ils en auront un, qui voudra d’eux ?
[1] Et, d’après l’Unicef, les taux de mortalité infantile restaient également très élevés en 2012 dans ces pays (coûtant la vie cette année-là à 2 millions d’enfants de moins de cinq ans) : 56 pour mille en Inde – soit le chiffre de la Chine en 1990 – et 86 au Pakistan. Le Bangladesh, lui, a fait beaucoup de progrès pour arriver à « seulement » 41 pour mille (contre 144 en 1990). En comparaison, la France en était à 4 décès de bébés sur mille en 2012.
[2] Comme en témoigne a contrario la tentative en 2008 des dirigeants de la firme coréenne Daewoo, certainement convaincus des réserves de productivité de la Grande Île, de louer (à très bas prix) près de la moitié de ses surfaces agricoles pour y produire intensivement de l’huile de palme et du maïs à exporter à son profit, ce qui a été une cause directe du coup d’État de 2009.
[3] Il est frappant d’y voir les champs de maïs arriver au ras des maisons, à l’exception d’un étroit sentier accédant à la porte d’entrée ; on sent bien que chaque mètre carré compte.
[4] La notion de « sous-population » est évidemment relative ; il n’est pas sûr que les intéressés s’en plaignent, même s’ils ont plus de difficultés à jouir d’infrastructures dites « modernes ». Et en tous cas, elle est totalement anthropocentrée : si l’on pouvait poser la question aux autres espèces (!),en particulier de la grande faune (tigres, lions, grands singes, etc.), elles répondraient à coup sûr qu’elles préféreraient un monde avec un minimum d’humains…
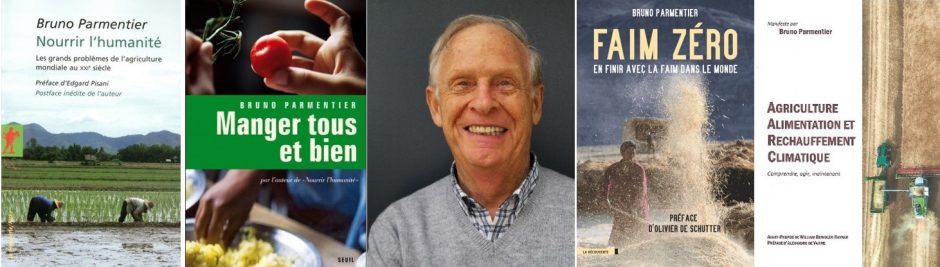
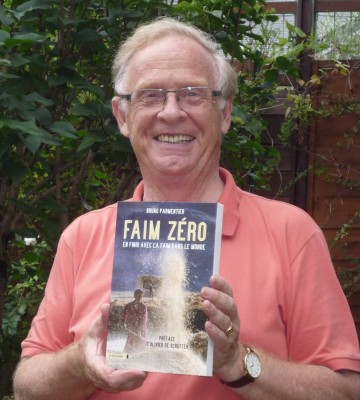
Félicitations M. Parmentier !! je suis un des plus fidèles lecteurs….Hâte de lire votre livre !Bon courage pour la suite !